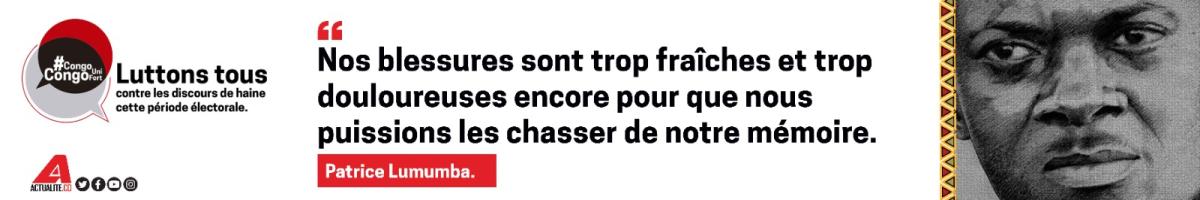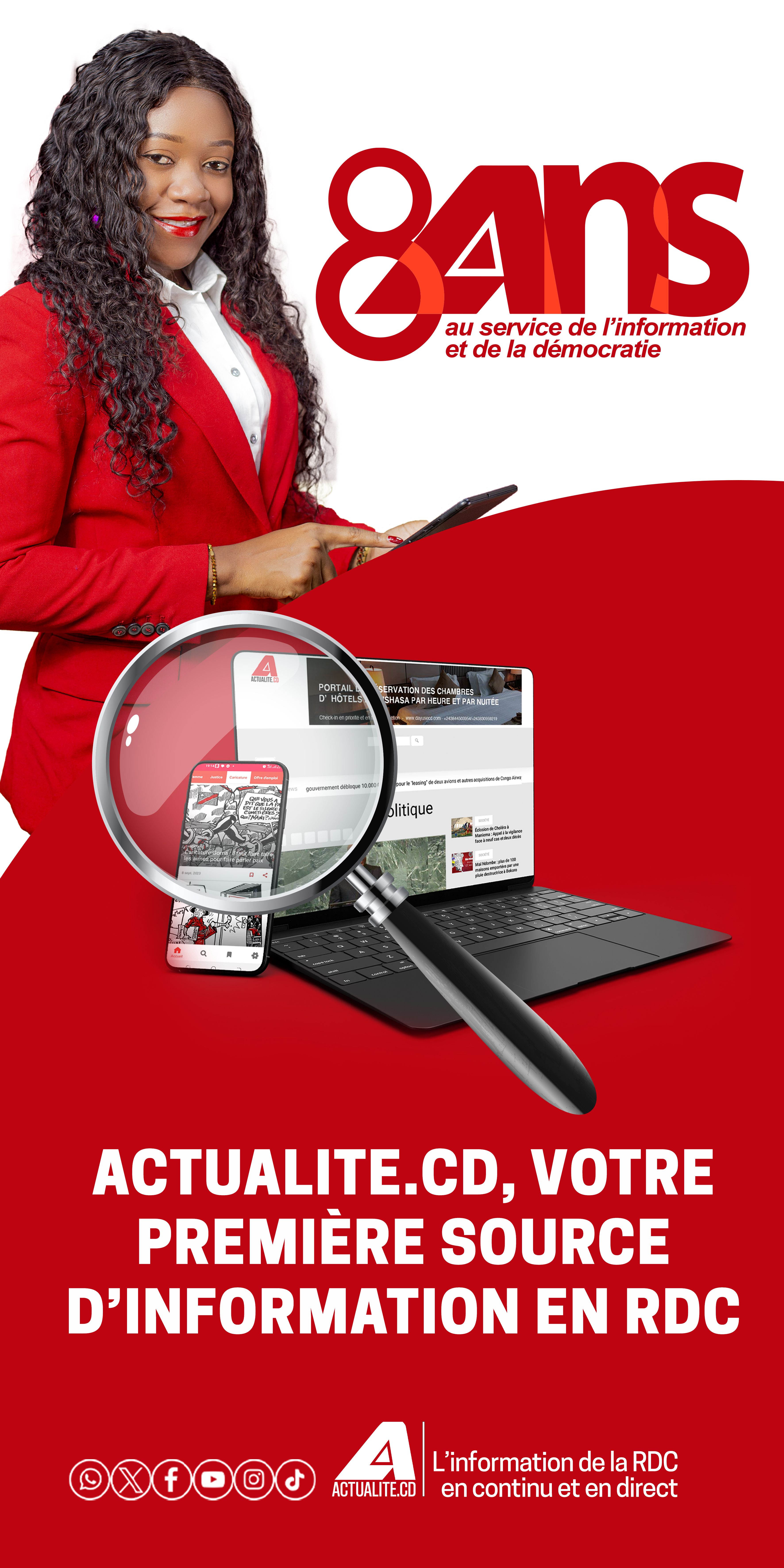Santé reproductive et hygiène menstruelle en RDC : les résultats de la troisième enquête démographique

- Femme
- Lundi 17 février 2025 - 17:44
La troisième enquête démographique et de santé (EDS) menée en République Démocratique du Congo entre 2023 et 2024 dresse un bilan détaillé sur les pratiques de santé reproductive et les conditions d’hygiène menstruelle des femmes congolaises.
L'enquête révèle que, parmi les femmes de 15 à 49 ans ayant eu leurs règles au cours de l'année précédente, les méthodes utilisées pour gérer les menstruations sont variées. Environ 38 % d’entre elles ont recours à des vêtements comme solution, tandis que 35 % optent pour des serviettes hygiéniques jetables. 19 % utilisent des serviettes réutilisables, et 3 % se contentent de coton ou de laine.
L’enquête souligne également qu'un nombre important de femmes, lorsqu’elles se trouvent à la maison durant leurs règles, ont la possibilité d’utiliser des matériaux appropriés tout en bénéficiant de l’intimité nécessaire pour se laver ou se changer. En effet, 84 % des femmes dans cette situation affirment avoir pu gérer leurs menstruations dans des conditions d’hygiène adéquates.
Fécondité : une tendance à la baisse mais des disparités persistantes
La fécondité en RDC reste élevée avec une femme ayant en moyenne 5,5 enfants au cours de sa vie féconde, contre 6,3 enfants en 2007. Cette fécondité varie selon les régions et les niveaux socio-économiques. À Kinshasa, la moyenne est de 3,4 enfants par femme, tandis que dans des provinces comme le Lualaba et le Maniema, elle grimpe jusqu'à 7,6 enfants.
Les disparités sont également marquées par le niveau d'instruction. Les femmes sans instruction ont en moyenne 6,2 enfants, tandis que celles ayant un niveau d’éducation supérieur en ont seulement 2,8. Ce phénomène est également observé en fonction du statut économique des femmes : celles issues du quintile le plus pauvre ont en moyenne 6,9 enfants, contre seulement 3,6 pour celles du quintile le plus élevé.
L'enquête met également en lumière les résultats des grossesses récentes en RDC. Sur toutes les grossesses survenues au cours des trois dernières années, 88 % ont abouti à une naissance vivante, 4 % à une fausse couche, 6 % à un avortement provoqué, et 2 % à un mort-né. Le taux d'avortement provoqué est plus élevé chez les femmes âgées de 45 à 49 ans et augmente avec le niveau d'instruction et le bien-être économique.
Nancy Clémence Tshimueneka