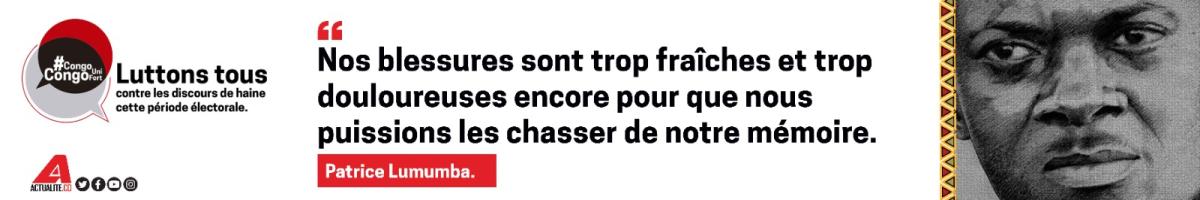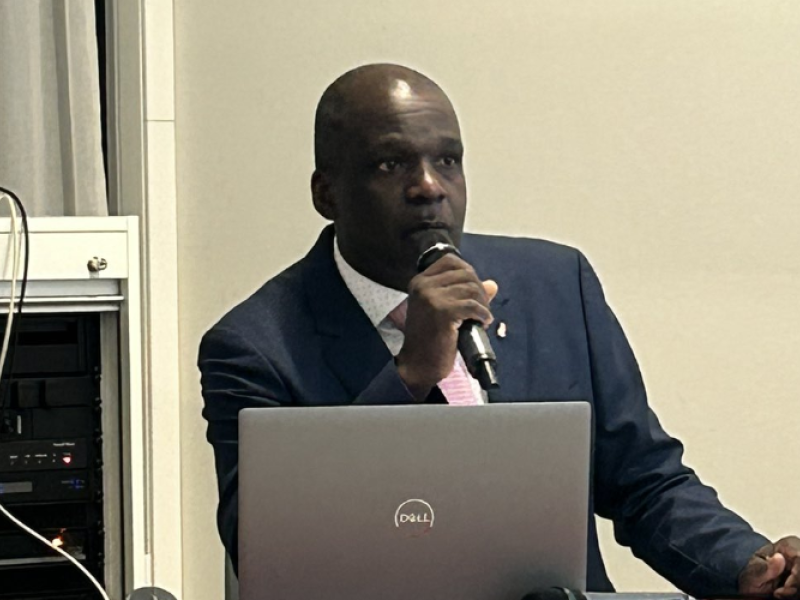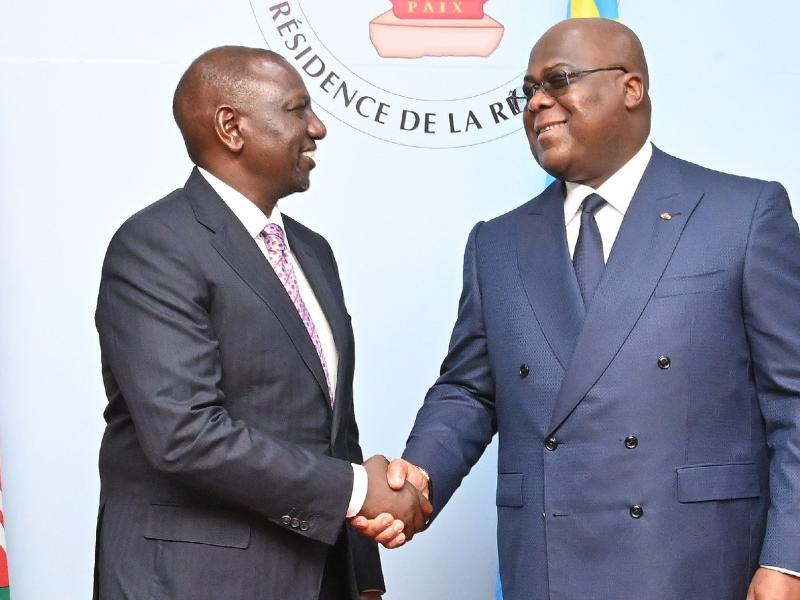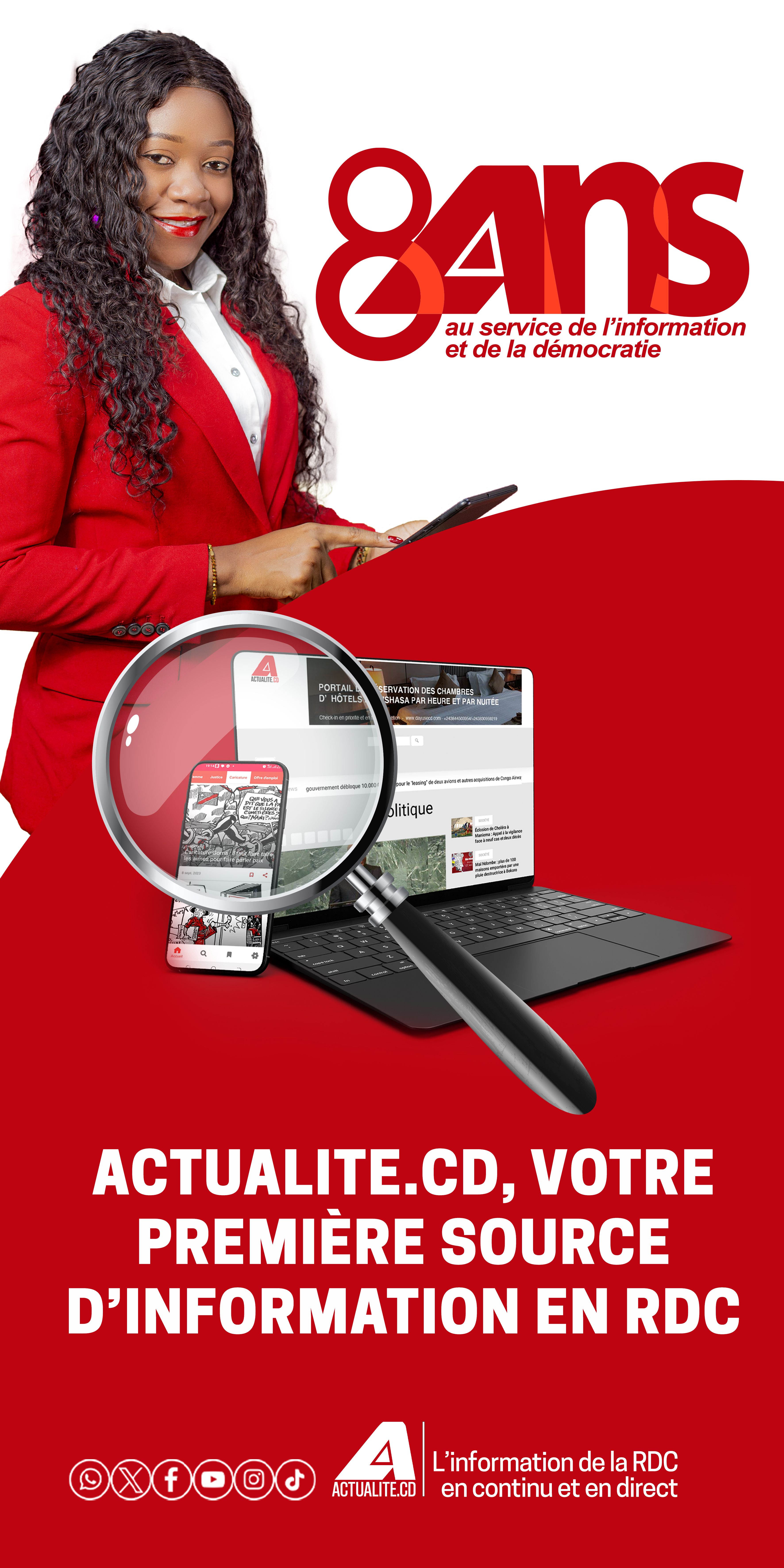Ce qu’il faut savoir sur la réglementation de change en RDC

- Justice
- Vendredi 3 juin 2022 - 08:57
Deux concepts composent cette notion à savoir celui de « réglementation » d’une part et celui de « change » d’autre part.
1. A titre de rappel, le concept de « réglementation » tire son origine du verbe « réglementer » qui signifie « soumettre à un règlement » c’est-à̀-dire soumettre à un certain ordre, à certaines prescriptions. Ainsi, par réglementation, l’on désignerait soit l’action de réglementer soit l’ensemble des mesures légales et réglementaires régissant une question, une matière.
2. On entend par « change », l’action ou l’opération de conversion d’une monnaie nationale en une autre monnaie nationale appelée « devise ». En effet, il est suffisamment connu qu’à l’exception de quelques zones monétaires disposant d’une monnaie commune (cas de l’euro et du franc CFA), chaque État souverain dispose de sa propre monnaie. Les échanges économiques entre différents États ne pouvant dès lors pas se réaliser au moyen d’une seule et même monnaie, les monnaies nationales sont destinées à s’échanger les unes contre les autres.
L’on imagine dès lors aisément l’ampleur des opérations de change qu’implique la multitude d’échanges économiques qui se tissent quotidiennement entre États et la nécessité pour chacun de ces derniers de disposer d’une réglementation des changes.
3. Partant de ce qui précède, il convient de s’accorder sur le fait que la réglementation des changes désigne l’ensemble des dispositions légales et réglementaires régissant les opérations de conversion d’une monnaie nationale contre les devises étrangères.
La monnaie nationale est un des symboles de la souveraineté́ étatique. Ce qui a fait dire à Constance Gwen que la réglementation des changes est « un ensemble de mesures qui ont pour objectif de définir les conditions dans lesquelles les monnaies nationales peuvent être échangées contre des devises étrangères et ce, dans le but de protéger et de conserver la valeur des monnaies nationales » (Constance Gwen, La réglementation des changes: une mesure de contrôle de la monnaie, in Aquadesign.be, mars 2007).
4. La réglementation des changes se voit ainsi conférer un but spécifique qu’est celui d’assurer la protection et la conservation de la valeur de la monnaie nationale.
5. Évolution historique de la réglementation des changes : L’histoire de la réglementation des changes a été marquée, au niveau international, par un processus de libéralisation résultant lui-même de la libéralisation des échanges économiques entre États et de l’ouverture des marchés ayant conduit ces derniers à assurer la convertibilité́ de leurs monnaies nationales respectives.
La plupart des États sont ainsi passés d’une politique dite de « contrôle des changes» à celle de «libéralisation des changes». Il s’est donc agi d’un mouvement de « déréglementation » consécutif au changement de politique en matière des changes.
6. Dans l’ensemble, la réglementation congolaise a été influencée par ces grandes mutations internationales même si à certaines périodes de l’histoire récente du pays l’on a eu l’impression de voguer à contre-courant.
Cette évolution peut être déclinée à travers les trois grandes étapes ci-après :
a) De 1967 à 1976 : Contrôle des changes avec rattachement du Zaïre-monnaie au dollar américain. A travers l’ordonnance-loi n° 67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Nationale du Congo en matière de réglementation du change, le régime du contrôle des changes hérité du système colonial est reconduit avec cette particularité́ que la nouvelle monnaie nationale, le Zaïre, est rattaché au dollar américain au moyen d’un taux de change fixe.
b) De 1976 à 1983 : Contrôle des changes avec rattachement du Zaïre-monnaie aux DTS. Si pendant cette période la politique antérieure est maintenue et avec les mêmes instruments (cessions de devises, contrôle des importations et exportations...), le Zaïre-monnaie s’est affranchi du dollar américain pour être rattaché aux Droits de Tirages Spéciaux (D.T.S.). Ce changement était justifié par l’instabilité́ des monnaies fortes dont le dollar américain.
c) De 1983 à ce jour : libéralisation des changes. Face aux effets pervers du contrôle des changes accentués par l’environnement économique et politique de l’époque, l'autorité monétaire s’est résolue à libéraliser le marché́ des changes en adoptant, à l’instar de ses partenaires internationaux, un régime de changes flottants. Cette libéralisation impliquait notamment la liberté de détention des monnaies étrangères, la libre fixation des cours de change par les banques commerciales et la création des bureaux de change.
Grâces Muwawa L., Desk Justice/ACTUALITE.CD