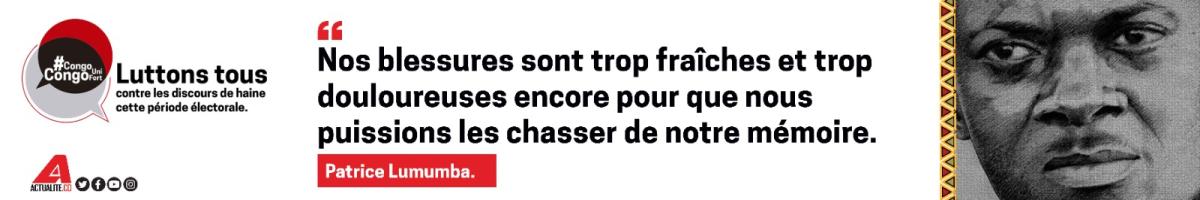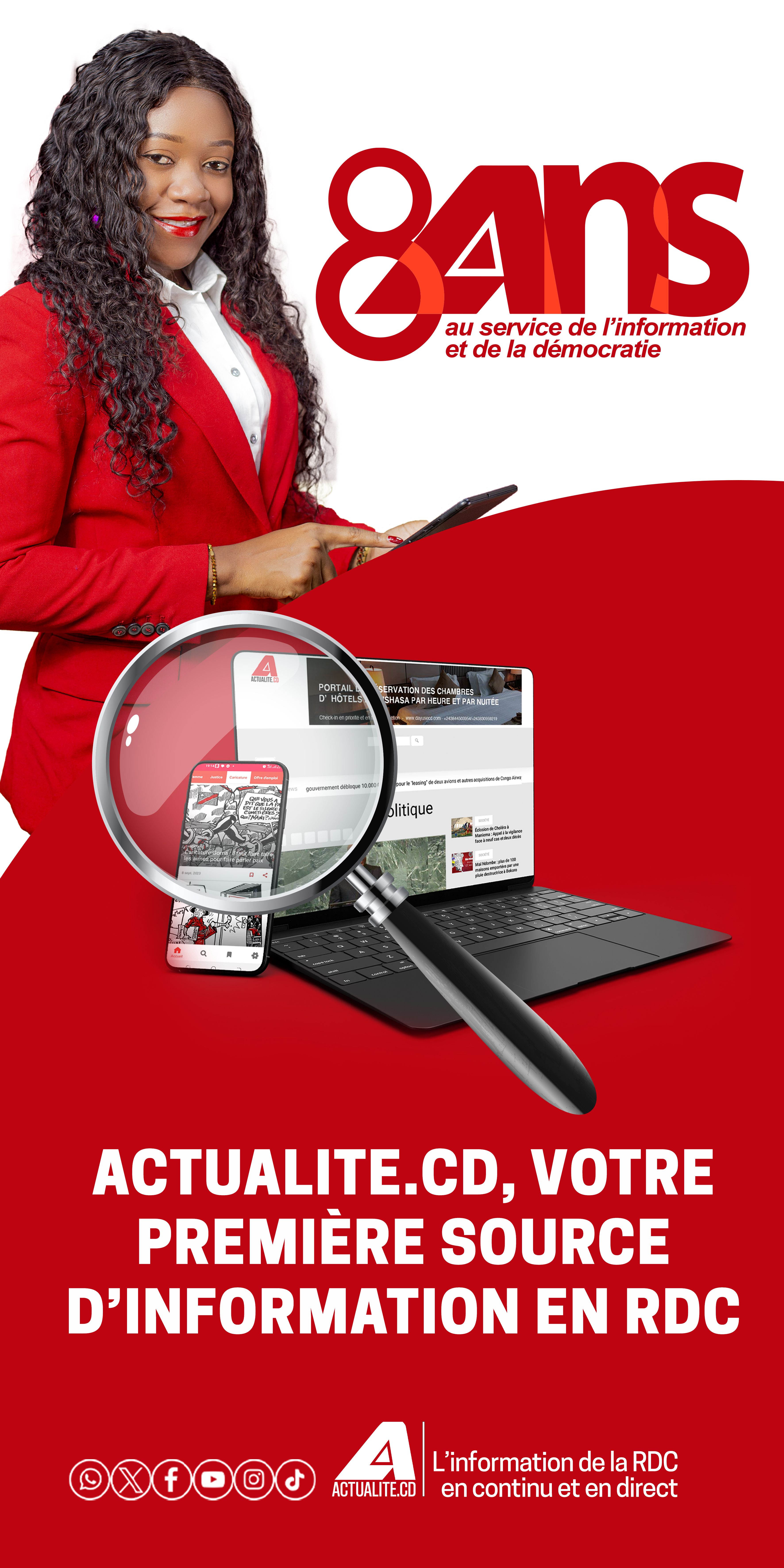Kinshasa : Retour sur les combats des femmes engagées dans la lutte pour l’égalité de genre

- Femme
- Dimanche 27 avril 2025 - 13:03
À Kinshasa, plusieurs femmes se mobilisent chaque jour pour défendre les droits des femmes et des jeunes filles. Grâce Shako et Merry Kapula font partie de ces militantes qui se battent contre les injustices, les inégalités et les violences faites aux femmes. À travers leurs actions, elles veulent construire une société plus juste, où chaque femme peut s’épanouir librement.
Le DeskFemme s’est entretenu avec elles ce jeudi 24 avril au sujet de leurs combats pour les droits des femmes et des défis qu’elles rencontrent dans cette lutte.
Grâce Shako : faire entendre la voix des sans voix
Journaliste de carrière et coordonnatrice de l’ONG Leadership de la Femme des Médias (LFM), Grâce Shako est également militante pour les droits des femmes. Son engagement est né d’une prise de conscience : « Les femmes congolaises sont restées figées dans des stéréotypes qui ne favorisent pas leur éclosion. Voir ces talents étouffés, ces vies limitées par la tradition ou la peur, m’a poussée à agir. »
Son parcours dans les médias l’a également convaincue de l’urgence de créer des espaces d’expression pour les femmes. À travers LFM, elle travaille au renforcement du leadership féminin, notamment chez les jeunes filles. « Nous combattons la sous-représentation des femmes dans les sphères de décision, la précarité économique des jeunes filles, et la banalisation des violences sexuelles. LFM lutte aussi contre les stéréotypes sexistes, en encourageant un leadership féminin audacieux et transformateur, porté par des jeunes filles conscientes de leur valeur. »
Dans un contexte parfois hostile au féminisme, Grâce Shako mise sur l’expérience vécue des femmes pour sensibiliser. « Nous partons de l’expérience de chaque femme, avec des récits de leurs parcours qui interpellent et poussent les autres femmes à se challenger. Je crois à la force du collectif, au dialogue avec les autorités, et à l’utilisation des médias pour relayer nos messages. En parlant vrai, en restant proches des réalités vécues, nous parvenons à sensibiliser, malgré les résistances. »
Mais le chemin est difficile. Elle dénonce « le manque de moyens, les pesanteurs socioculturelles, le manque d’engagement de toutes les parties prenantes, et parfois même politique », qui freinent leur action. Pourtant, Grâce reste confiante : « Chaque petit progrès, chaque femme qui se relève, chaque fille qui ose rêver grand, me donne la force de continuer. Le changement est difficile, mais il est possible. »
Pour elle, les alliances sont essentielles. « Les alliances locales comme avec Afia Mama ou le Consortium de Solidarité Humanitaire RDC sont essentielles. Au niveau régional, des structures telles que J-Gen Sénégal, Voix Féministe Africaine et le Réseau des Jeunes Féministes d’Afrique Centrale apportent un dynamisme précieux à notre travail. Sur le plan international, la collaboration avec ONU Femmes nous permettra de renforcer notre impact et de porter plus haut les revendications des femmes congolaises. »
Merry Kapula : redonner espoir à la jeune fille congolaise
Merry Kapula est journaliste de formation, activiste engagée et fondatrice de l’association Hope Live, basée à Kinshasa. Depuis plusieurs années, elle consacre toute son énergie à l’autonomisation de la jeune fille congolaise, à travers des actions concrètes de sensibilisation dans les écoles, les marchés et les quartiers populaires.
« Je crois profondément que chaque fille a le droit de rêver, de grandir, de s’éduquer et de réussir, peu importe son origine ou ses conditions », affirme-t-elle. Son engagement est né de l’observation d’une « réalité brute : des jeunes filles pleines de potentiel, réduites au silence par la pauvreté, la violence, les traditions étouffantes. J’ai vu des rêves s’éteindre faute de soutien, des voix se taire par peur ou par honte. »
Son propre parcours, semé d’obstacles, l’a renforcée. « En tant que femme ayant dû moi-même franchir des obstacles pour me faire une place, je ne pouvais pas rester indifférente. Mon parcours est ma source de force. Aujourd’hui, j’en fais un levier pour tendre la main aux autres. »
Merry Kapula et Hope Live combattent plusieurs formes d’inégalités :
– Le décrochage scolaire des filles, souvent causé par les grossesses précoces ou le manque de moyens.
– Les violences sexuelles et conjugales, encore trop banalisées.
– L’absence de représentativité des femmes dans les espaces de pouvoir.
– Le poids des normes sociales qui freinent l’ambition des filles.
L’approche de Hope Live est de proximité. « D’abord, en parlant vrai. En allant vers les gens, sans discours élitiste. Nous utilisons les histoires vécues, les témoignages, les ateliers interactifs, même dans les lieux les plus reculés. Nous misons aussi sur la création de liens de confiance, en impliquant les familles, les chefs de quartier, les enseignants, pour que le message devienne communautaire. Et nous travaillons en réseau avec d’autres femmes leaders, car ensemble, notre voix porte plus loin. »
Le combat est difficile, mais elle ne baisse pas les bras. « Le plus dur, c’est parfois de voir le système résister au changement, même quand la souffrance est visible. Mais je garde espoir grâce à chaque fille qui se relève, qui reprend ses études, qui ose parler en public, qui crée un projet, qui croit à nouveau en elle. Ce sont ces petites victoires silencieuses qui nous rappellent que notre combat porte du fruit. Et qu’il faut continuer. »
Comme Grâce Shako, Merry Kapula croit à la force des alliances. « Nous avons besoin de synergies locales avec les écoles, les médias, les ONG, les associations de quartier. Mais aussi de liens régionaux et internationaux pour échanger, apprendre, et amplifier notre plaidoyer. Les partenariats avec des institutions comme ONU Femmes, le Fonds mondial, ou des mouvements panafricains féminins sont essentiels pour peser dans le débat public et institutionnel. L’avenir du féminisme en RDC dépendra aussi de notre capacité à nous unir, à parler d’une seule voix, au-delà des clivages. »
Nancy Clémence Tshimueneka