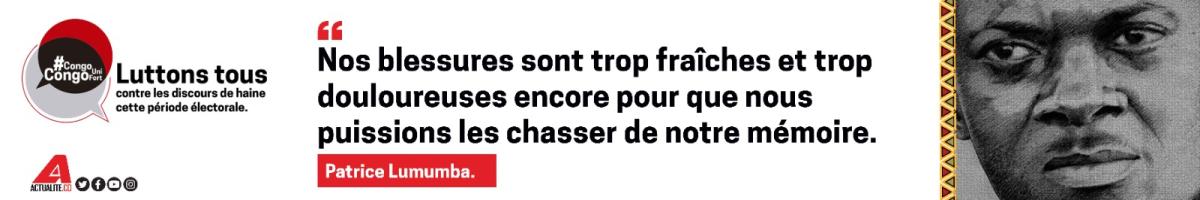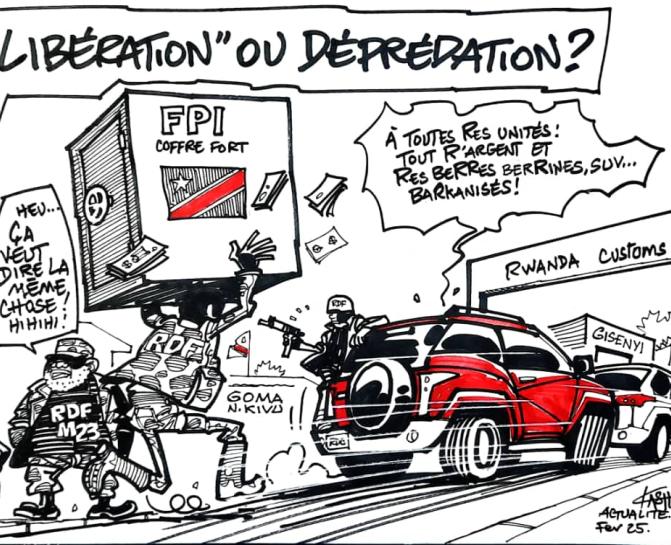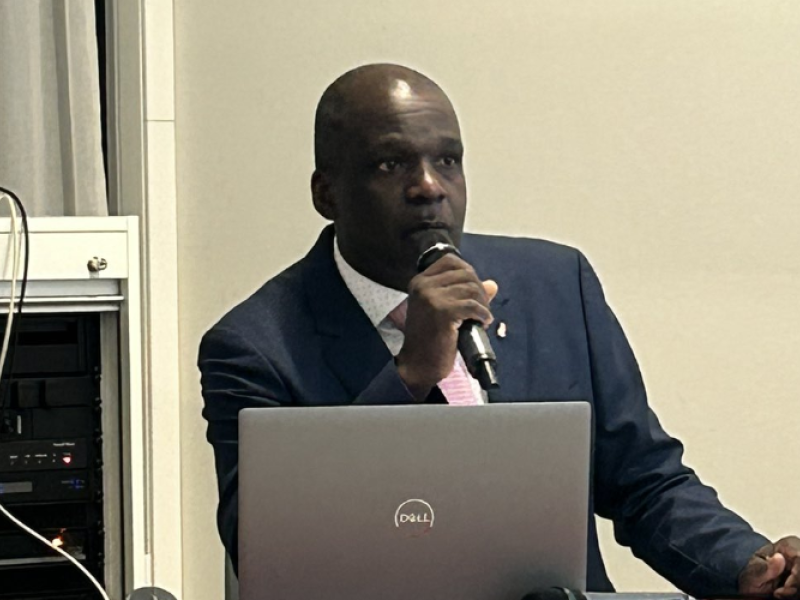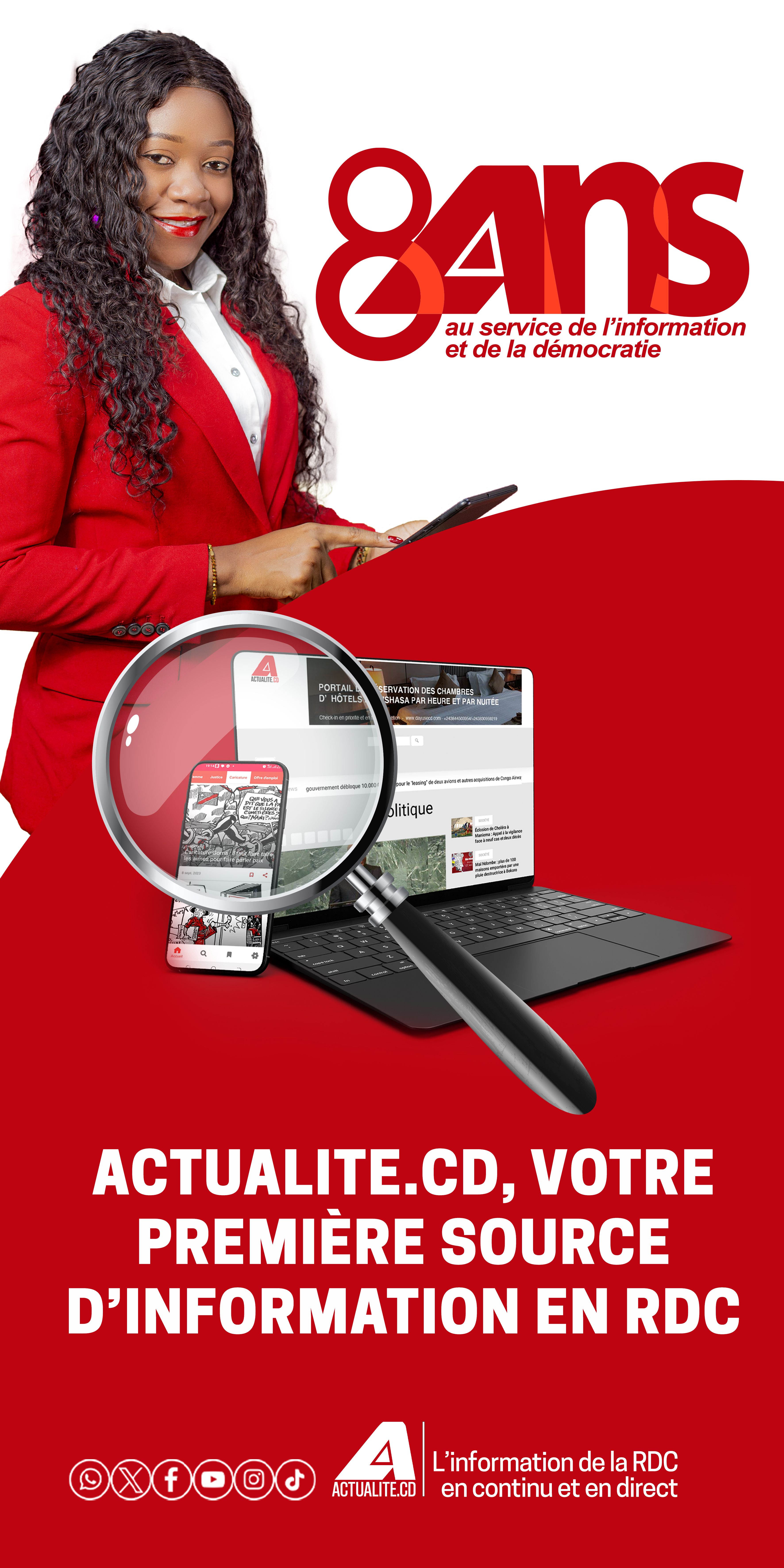Analyse – critique de l’arrêt avant-dire droit du 22 juillet 2022 de la Cour de cassation congolaise sous le RP 09/CR, en cause MP c/ Matata Ponyo et csrts
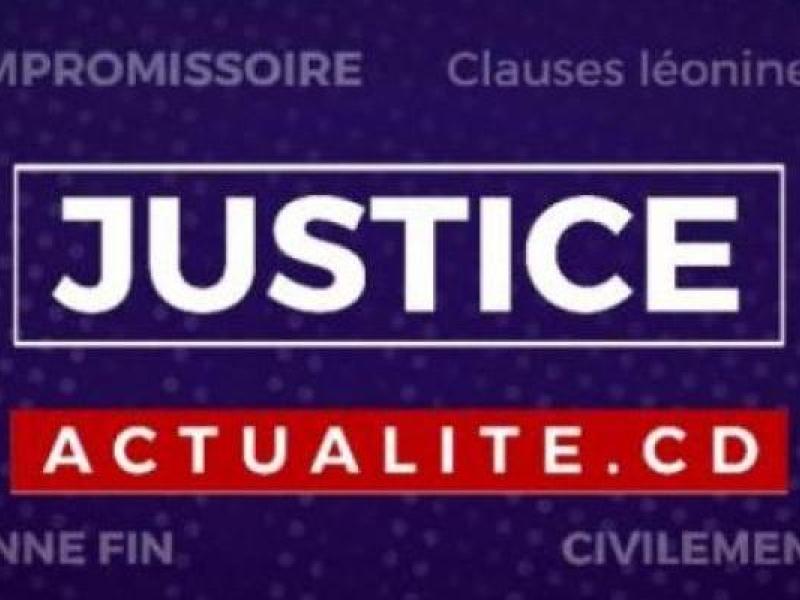
- Justice
- Vendredi 22 juillet 2022 - 19:00
Par Grace Muwawa Luwungi
Assistant à la Faculté de Droit et doctorant en Droit
Desk Justice/Actualité.cd
« Le droit, une science occulte. Plus difficile que les mathématiques, la physique et la chimie, le droit hait les automates, les marabouts et les maîtres penseurs, ainsi que leurs formules de pensée unique et chemins raccourcis. Le droit est beau, mais le raisonnement en droit est difficile ».
Vendredi 22 juillet 2022, alors que les parties en cause devant la Cour de cassation attendaient que cette dernière se prononça sur les différents déclinatoires de compétence soulevées, notamment du fait que l’un des prévenus est poursuivi pour des actes infractionnels commis dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’il était Premier Ministre, et ce en se fondant sur les articles 163 et 164 de la Constitution qui désignent la Cour constitutionnelle comme seul juge pénal du Premier Ministre pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Rendant un arrêt avant-dire droit en lieu et place d’un arrêt définitif sur incident, la Cour a, malheureusement, décidé de surseoir et saisir la Cour constitutionnelle, requérir de ce juge de la Constitution l’interprétation des dispositions des articles 163 et 164.
Ce qui appelle les observations (purement scientifiques) suivantes :
A. Au sujet du déclinatoire de compétence
1. En effet, en droit judiciaire congolais, la cour ne dispose que de trois moyens pour se libérer d’un déclinatoire de compétence soulevé devant sa juridiction : soit il se prononce par un arrêt définitif sur incident rejetant le déclinatoire, soit par un arrêt définitif sur incident retenant l’exception soulevée en la déclarant fondée, et par conséquent se dessaisit de la cause, ou alors par un arrêt avant-dire-droit joignant le moyen exceptionnel au principal, et demander aux parties de plaider à toutes fins utiles, en application de l’article 26 du CPC.
2. L’exception d’incompétence, appelée aussi le déclinatoire de compétence, est un moyen soulevé par le défendeur lorsqu’il estime que le demandeur (ici l’accusateur) a porté son action en justice devant la juridiction qui n’est pas compétente en vertu de la loi (MUKADI Bonyi et KATUALA Kaba Kashala, Procédure civile, Kinshasa, Edition Batena Ntambua, 1999, p. 267). L’expression « en vertu de la loi », utilisée par le Professeur MUKADI BONYI et le Procureur général KATUALA, signifie simplement que l’exception d’incompétence ou le déclinatoire de compétence, étant une exception d’ordre public, ne peut avoir pour fondement que la loi et seulement en vertu de la loi qui lui donne toute sa force et sa valeur juridique. Par loi, entendez ici « la Constitution ».
3. La règle est qu’il n’y a d’exception d’incompétence qu’elle soulève un conflit d’attribution entre juridictions différentes (Soc. 25 oct. 1965, Bull. Civ. IV., n° 708). S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire savoir devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée (Article 75 du NCPC ). C’est dans le déclinatoire, et non ultérieurement, que l’auteur de l’exception doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction il demande que l’action soit portée (Civ. 1ère, 28 avril 1982, Bull. Civ. I, n° 150).
4. Cependant, il n’est nullement exigé, pour que l’exception d’incompétence soit recevable, que la juridiction désignée par le défendeur soit réellement compétente. Si le juge constate après examen de l’exception soulevée par devant sa juridiction, la juridiction désignée par le défendeur n’est pas celle-là qui est compétente, il déclarera le moyen recevable parce qu’ayant respecté les conditions et les étapes pour sa recevabilité, mais la déclarera par contre non-fondée en droit, sa décision qui devra ainsi être motivée. Cette motivation devra alors être assise sur le droit positif, sur la loi, ou sur la volonté des parties contenue dans le contrat ou dans la convention d’arbitrage.
B. Au sujet de l’interprétation de la Constitution par le juge
1. Qu’est-ce qu’est « interpréter » ?
C’est chercher le sens des mots et des phrases, le sens de la volonté exprimée par l’auteur de la règle de droit. Seule compte, en réalité, la démarche du juge qui, pour résoudre le litige qui lui est soumis et pour étayer valablement la décision qu’il va prendre, entend déterminer la signification exacte des règles de droit qui s’imposent à lui (Francis Delpérée, La Constitution et son interprétation, Bruxelles, Presse universitaire de Saint Louis, 1978, p. 187 – 210).
2. Interpréter, c’est aussi expliquer. C’est rassembler les termes, les concepts ou les notions qui pourront éclairer ce qu’un texte présente d’obscur ou d’ambigu. C’est faire connaître les causes ou les conséquences qui s’attachent à une disposition dont la signification n’apparaît peut-être pas du premier coup d’œil. Mais — là réside toute la différence entre le commentaire et l’interprétation — il n’appartient pas au juge d’assortir cette explication de remarques ou de critiques même si elles peuvent faciliter l’intelligence de la règle de droit (Ibid).
3. Qui est juge de l’interprétation d’une disposition de la Constitution ?
Articles 161 alinéa 1er de la Constitution et 54 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle : « La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution (…) ».
4. Qui saisit la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ?
Articles 161 alinéa 1er de la Constitution et 54 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle : « La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution à la requête du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et des Présidents des Assemblées Provinciales ».
5. Les juges de la Cour de cassation ont-ils qualité pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution ? Ne serait-ce pas là une occasion de se faire ridiculiser par la Cour constitutionnelle qui déclarera leur action irrecevable pour défaut de qualité flagrant ?
Nous continuons à y réfléchir.
C. La Cour constitutionnelle n’a-t-elle pas déjà interprété les articles 163 et 164 de la Constitution dans son arrêt sous RP 001 du 15 novembre 2021 ?
Rappelons, bien avant d’examiner l’arrêt RP 001 du 15 novembre 2021, que le doyen Louis Favoreu désigne, par interprétation, d'une part « une opération d'explication et d'analyse scientifique de la signification d'un texte », ce qui est pour lui le propre du travail doctrinal (la doctrine) ; mais il désigne également « le fait qu'un organe (la Cour) applique un texte à un cas particulier ». Cette opération ressemble évidemment à la première, du fait que l'organe doit lui aussi analyser le texte, mais ce qui est visé dans ce second sens, c'est le fait que cet organe « concrétise une norme relativement plus générale par une norme relativement plus particulière ».
En effet, nous lisons sur le 13ème feuillet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle sous RP 001 du 15 novembre 2021 ce qui suit :
« L'article 164 quant à lui dispose : « la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ».
Elle observe que l'article 164 de la Constitution reconnaît au Président de la République et au Premier ministre un privilège de juridiction tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examiné par une juridiction de l'ordre judiciaire. En plus, il est nécessaire que le Président de la République ou le Premier ministre soit à l'abri des poursuites, comme tout citoyen, qui empêcheraient l'exercice des pouvoirs que leur confère la Constitution.
Elle note que, tout comme les députés et sénateurs bénéficient du privilège et des immunités des poursuites et de l'inviolabilité, les poursuites contre le Chef de l'Etat se heurtent également aux contraintes procédurales difficiles à surmonter. Bien qu'ils ne bénéficient pas d'une immunité absolue, le Président de la République et le Premier ministre bénéficient d'un régime dérogatoire au droit commun pour toute infraction par eux commise. Il suit de ce qui précède que le constituant vise la protection des fonctions du Président de la République et du Premier ministre en exercice, lesquelles sont attachées à leur mandat.
La Cour considère que pendant la durée de ses fonctions, le Premier ministre ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que devant la Cour constitutionnelle ; pour tous ses actes, y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions, il bénéficie d'un privilège de juridiction le mettant urgemment à l'abri puisque les particuliers ne peuvent saisir celle-ci. Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires.
N'est-ce pas là une œuvre d’interprétation des dispositions des articles 163 et 164 de la Constitution par la Cour ?
Nous lisons encore sur le 15ème feuillet du même arrêt ce qui suit :
« En l'espèce, la Cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin a été Premier ministre de 2012 à 2016 ; qu'à ce jour, il n'exerce plus lesdites fonctions.
Elle relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Ponyo Augustin, qui a cessé d’être Premier Ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et ce en violation de l'article 19 alinéa 1 de la Constitution.
De ce fait, le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin ne saurait être poursuivi devant elle sur base de l'article 163 de la Constitution.
Elle rappelle que la théorie de l'interprétation du droit pénal est marquée par le caractère strict de l'interprétation, et est basée sur le principe de la légalité des délits et des peines. De même, la procédure pénale est caractérisée par le principe selon lequel la loi doit être prévisible et accessible. Une décision judiciaire condamnant un prévenu au mépris de ce principe ne peut être régulière. »
N'est-ce pas là encore une œuvre d’interprétation ? Quel est, en vrai, l’intérêt caché de l’arrêt de la Cour de cassation de ce jour ?
Le droit est beau, mais le raisonnement en droit est difficile.